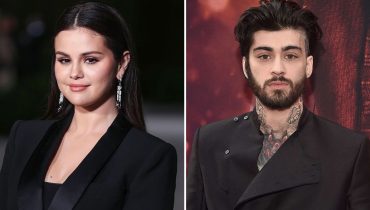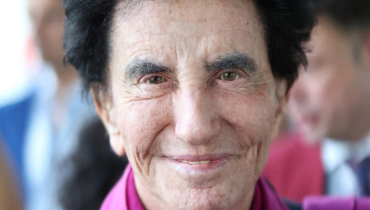Elle lui donne un rein par amour… Il la quitte, et elle réclame son organe

Posted 28 juillet 2025 by: Admin
Lorsque l’amour s’efface, les cicatrices laissées ne sont pas que sentimentales. Un témoignage rare relance la question troublante : peut-on réclamer un organe offert à l’être aimé ? Entre émotion, droit et éthique médicale, la greffe d’un rein devient ici le point de départ d’un débat profondément humain.
Dans l’émission “Legend”, animée par Guillaume Pley, un chirurgien partage une anecdote qui défie le bon sens autant que le droit. Karim Boudjema, éminent spécialiste en chirurgie digestive et greffes, évoque le cas étonnant d’une femme qui, après avoir fait don d’un rein à son mari malade, a voulu le récupérer suite à leur séparation. Ce dernier, une fois rétabli, aurait quitté son épouse pour une autre. « Très bien, mais tu me rends mon rein », aurait-elle exigé au moment de la rupture. Si cette situation peut prêter à sourire, elle s’appuie en réalité sur un fait divers bien réel ayant secoué la presse britannique il y a une décennie.
L’affaire Samantha Lamb : l’amour trahi… jusqu’à la moelle
L’histoire fait écho à celle de Samantha Lamb, une Britannique ayant fait don d’un rein à son époux en 2008. Mais leur histoire d’amour vire au désastre lorsque, cinq ans plus tard, le mari la quitte. Samantha, dévastée, affirme dans la presse : « Je le déteste. Si je le pouvais, je retournerais sur la table d’opération et je donnerais le rein à quelqu’un d’autre. » Plus qu’une querelle de couple, cette affaire révèle les limites émotionnelles et juridiques de la générosité entre conjoints. Pourtant, sur le plan légal, une chose est sûre : ce qui a été donné ne peut être repris.
Une greffe n’est pas un bien qu’on partage
Contrairement aux meubles ou aux comptes bancaires, un rein donné ne figure pas au patrimoine divisible. Comme l’explique Karim Boudjema, « une greffe ne se règle pas comme une succession ou un divorce. » En France, la procédure est rigoureusement encadrée : un don d’organe entre vivants implique l’intervention du procureur de la République, qui vérifie l’absence de pression et la pleine conscience du donneur. Cela permet d’éviter que l’acte chirurgical ne soit instrumentalisé à des fins affectives, conflictuelles ou intéressées.
Qui peut donner un organe en France ?
Le don d’un rein (ou d’un lobe de foie) entre vivants est autorisé sous conditions très précises. La personne doit appartenir au cercle familial ou affectif du receveur : père, mère, frère, sœur, conjoint, grands-parents, cousins germains, ou toute personne vivant sous le même toit depuis au moins deux ans. Dans tous les cas, le lien affectif doit être réel, stable et justifié. Cela permet d’écarter tout soupçon de transaction ou de contrainte, garantissant ainsi le caractère désintéressé du geste.
Le consentement, pierre angulaire de la procédure
Avant toute intervention, le donneur doit rencontrer un juge pour confirmer son accord. Ce consentement doit être libre, éclairé et réversible jusqu’à la dernière minute. À ce stade, un comité de donneurs vivants, indépendant de l’équipe médicale, est aussi sollicité pour évaluer la sincérité de la démarche. Ce rempart éthique vise à protéger les individus vulnérables, notamment dans les cas où les dynamiques conjugales peuvent fausser la perception du risque ou du sacrifice.
La gratuité, une règle absolue
Le don d’organe entre vivants repose intégralement sur un principe de gratuité. Aucun paiement ou compensation n’est autorisé, même symbolique. Seuls les frais liés à la procédure — comme les transports ou les pertes de revenus — peuvent être pris en charge pour garantir une neutralité financière. Cela évite toute marchandisation du corps humain et renforce la valeur éthique du don : un acte de pur altruisme, sans arrière-pensée ni retour attendu.
Peut-on reprendre son organe ?
En France, juridiquement, la réponse est sans appel : non, un organe donné ne se reprend pas. Même si le donneur change d’avis après la greffe, aucun recours n’est possible, et ce pour des raisons éthiques, médicales et humaines évidentes. Karim Boudjema le confirme avec fermeté : « En France, jamais. Ça ne se vend pas. » Cette intransigeance protège à la fois la dignité du patient et la confiance dans le système de santé. Elle rappelle aussi que le don d’un organe est irréversible, comme une promesse faite au corps autant qu’au cœur.